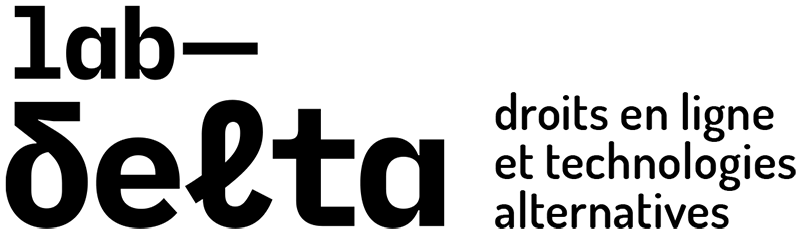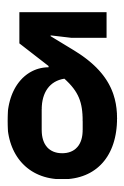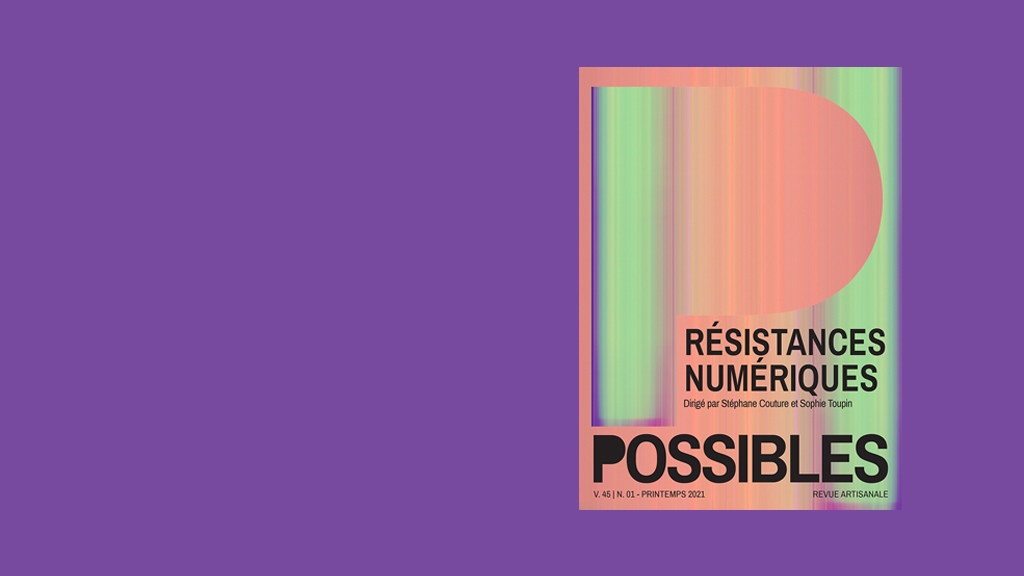Par Laurence McFalls
Résumé
L’université n’a jamais été à la hauteur de la vision idéalisée qu’elle projette d’elle-même. Cet idéal d’un haut lieu du savoir où le jeu libre, équitable et désintéressé des idées, des faits et de la raison qui nous permettraient collectivement de nous rapprocher d’une certaine vérité, sinon de la vérité certaine, s’est toujours fait gruger par des ambitions individuelles, des lourdeurs administratives, des interventions politiques et des préjugés idéologiques pour ne nommer que ces sources d’interférence. Dans sa célèbre conférence « Wissenschaft als Beruf » de 1917,1 Max Weber décrit déjà la prolétarisation du métier du savant, le caractère inhabituellement « arbitraire » de son avancement professionnel, le « grand nombre de médiocres [qui] jouent incontestablement un rôle considérable dans les universités », et la perversité des décisions prises collectivement, aussi collégiales qu’elles puissent être. Après cette douche froide de réalisme, Weber continuait de décourager son public d’aspirants-savants en leur faisant comprendre que la science ne leur fournirait pas la clef du sens de la vie, que l’établissement d’une vérité était vite dépassé, et que la connaissance réflexive ne recélait de la vérité que pour ceux qui la valorisent. Ainsi, seuls ceux dotés d’une forte volonté de savoir et d’une bonne capacité d’autocritique jouissaient, pour Weber, de la vocation de savant.
Un siècle plus tard, le métier et la vocation de savant ne s’exercent pas dans de meilleures conditions. Dans des circonstances de surspécialisation et d’hypertechnicisation au point de favoriser l’idiotie savante, les conditions matérielles et institutionnelles du travail scientifique produisent encore plus de contraintes, d’arbitraire et de conséquences non intentionnelles qu’à l’époque de Weber. Mais, pis encore, la motivation intrinsèque de la recherche scientifique – la quête (sans fin) de la vérité – n’est plus l’idéal de l’institution universitaire censée encadrer la production, la critique et la dissémination des savoirs prétendant à une certaine vérité.
Le travestissement de la mission universitaire à propos duquel je veux écrire ici n’est pas celui de la perversion de ses idéaux par la pratique imparfaite, ni celui de la marchandisation néolibérale du savoir, ni encore celui de la rectitude politique qui veut subordonner le savoir scientifique à d’autres valeurs. Ceux-ci sont sérieux et intenses, mais pas du tout nouveaux. Dans sa conférence de 1917 comme dans toute son œuvre, Weber cherchait à bannir les arguments politiques des raisonnements scientifiques, tout en reconnaissant le rôle des orientations de valeur dans la définition des problématiques et des outils conceptuels de la recherche. En même temps, il regrettait que « les grands instituts de science et de médecine [soient] devenus des entreprises du “capitalisme d’État” ». Cependant, il reconnaissait que la forme de la propriété des entreprises de production du savoir ne changerait rien à la logique bureaucratique et rationalisée de l’accumulation spécialisée des connaissances. Ainsi prétendrait-il probablement que la privatisation (ou patrimonialisation) actuelle des produits et des processus du travail universitaire, largement étatisés pendant le dernier siècle, aurait aussi peu de conséquences fondamentales que la socialisation des moyens de production capitaliste. Resterait intouchée la logique de la recherche systématique et effrénée, voire tragiquement absurde, de la productivité toujours accrue qu’elle soit du capital ou du savoir, à réinvestir et à renouveler.
Ce que Weber n’a pourtant pas anticipé, c’est que la science moderne, comme le capitalisme, se détache de ses fondements rationnels. La recherche systématique et sans fin de la vérité, notamment sous sa forme institutionnalisée par excellence qu’est l’université moderne, abandonne l’objectif (fuyant) de la vérité en faveur de ce que j’appelle la vérisimilitude. Avant d’esquisser les conditions historiques et théoriques de cette rupture épistémologique qui a vidé l’université de sa mission propre, je débuterai, à l’instar de Weber en 1917, par les conditions matérielles et institutionnelles du travail universitaire telles que je les ai vécues.
La néolibéralisation de l’université
Au début de mes études doctorales dans les années 1980, les perspectives de décrocher un poste de professeur menant à la permanence étaient, disait-on, bonnes. Ma diplomation devait coïncider avec une vague de départs à la retraite des professeurs engagés dans les années 1960 et 1970, soit durant la période d’investissement massif de l’État-providence technocrate dans l’éducation postsecondaire pour absorber les baby-boomers. Mon optimisme professionnel ne me permettait pas de prévoir les coups durs du néolibéralisme et sa volonté de démanteler l’État-providence. Jusqu’à aujourd’hui, la grande ouverture du marché de l’emploi professoral se fait encore attendre (contrairement à celui des gestionnaires universitaires.). Ainsi, je me considère comme l’un des « derniers des Mohicans » (si j’ose m’approprier le terme) pour avoir quand même pu mener une carrière universitaire de recherche et d’enseignement plutôt libres grâce à la sécurité d’emploi. Une telle carrière n’existe plus que dans l’imaginaire idéal-typique qui trompe et déçoit encore quelques jeunes mal conseillés. Durant les années 1990, nous subissions l’austérité budgétaire et les coupures de postes ainsi que l’augmentation des charges de travail. En effet, nous devions accueillir de plus en plus de clientèles étudiantes (ce dernier mot n’ayant pas encore été largué), toujours dans l’espoir qu’il y aurait un retour à la « normale » une fois la thérapie de choc passée.
Je ne me suis rendu compte de la dégradation de mes conditions de travail à l’université qu’après une année sabbatique et une autre année de congé sans solde consacrées à ma famille, à la recherche libre et à la rédaction de deux livres. À mon retour, la première et dernière grève professorale de l’histoire de l’Université de Montréal m’a donné l’occasion de m’engager fortement dans mon syndicat – tout compte fait, une action d’arrière-garde noble mais vouée à l’échec – et de m’impliquer dans la politique universitaire – une action encore plus futile, ingrate et surtout dégradante. Je n’entrerai pas dans le détail de ces mauvaises expériences qui me poussent à prendre ma retraite le plus tôt possible. Elles m’ont cependant permis de connaître le fonctionnement de l’institution mieux que la plupart des collègues qui, à juste titre, préfèrent s’illusionner que le cadre institutionnel n’a pas d’incidence sur leurs recherches et enseignements. J’ai aussi nourri cette illusion en me lançant simultanément dans de grands projets de recherche et de formation internationaux et bien subventionnés, participant ainsi moi- même de l’intérieur à la stratégie néolibérale de l’université désormais mondialisée et entrepreneuriale.
Il m’arrive parfois d’être presque nostalgique de cette période de l’université néolibérale. Bien que destructrice et hypocrite, le néolibéralisme dans son versant universitaire maintenait encore la mission de la production scientifique rationnelle. Après tout, la précarisation du corps professoral visait à l’inciter à faire plus avec moins, à chercher de nouveaux partenaires ainsi que de nouvelles clientèles, à produire non seulement des efficiences et des économies d’échelle, mais aussi de nouveaux objets de recherche. Durant les années 2000, sous l’administration de l’avant-dernier recteur, la direction exigeait que pour recevoir des moyens supplémentaires il fallût d’abord faire preuve de résultats, le tout sans compter ses heures. Par exemple, mon département a donc dû tripler sa « clientèle » avant de récupérer les postes de professeur et de personnel de soutien perdus. Entre-temps, les professeurs s’étaient habitués à leur nouveau statut de « prolétaire » et à leur travail scientifique ultraspécialisé. Ils étaient devenus des « entrepreneurs » qui devaient s’occuper de vraiment tout !
Sous le dernier rectorat, un virage s’est pris si graduellement que j’ai tardé à me rendre compte que l’université avait délaissé le néolibéralisme pour quelque chose d’encore pire. Comme dans la société englobante, le discours de l’austérité et la pratique de la précarité planifiée comme technique de culture de la « résilience » (terme sur lequel je reviendrai) n’ont pas disparu. On ne parle plus de travailler plus avec moins de ressources – peut-être parce que le discours a déjà été intériorisé par tous. Le nouveau discours est celui de la qualité, ou plutôt de la promotion de la qualité parce que la qualité en question n’est pas celle de la production universitaire, mais de son image. Le succès de l’entreprise universitaire se mesure désormais par son ranking. Certes, les grandes découvertes, les contributions à l’avancement des connaissances et leur diffusion comptent quelque part dans ces divers schèmes de ranking, dont la légitimité ne repose pas sur la validité des critères choisis, mais bien sûr la volonté des directions des universités de se prêter au jeu. Noyés dans des critères surtout subjectifs tels que la réputation, la visibilité ou l’expérience étudiante, la recherche et l’enseignement sont subordonnés aux impératifs d’une stratégie de marketing dictée, de préférence, par des consultants externes à l’université.
Ce passage de l’université du monde des connaissances au monde des apparences n’est ni superficiel ni anecdotique. Il est fondamental et catastrophique. Du moins, c’est ce que je compte argumenter le plus brièvement possible en faisant appel à mes recherches et réflexions sur le néolibéralisme et son glissement en tant que discours et mode de gouvernement vers ce que j’appelle le postlibéralisme.
Pour comprendre le triste sort de l’université actuelle, il faut situer l’université de recherche moderne dans le contexte de l’histoire du libéralisme, qu’il faut à son tour saisir comme étant beaucoup plus qu’une doctrine ou une idéologie politique et économique. Suivant et extrapolant à partir de l’analyse du libéralisme et du néolibéralisme que Michel Foucault a proposée dans ses cours au Collège de France pendant la deuxième moitié des années 1970, j’ai développé, en collaboration avec ma collègue anthropologue Mariella Pandolfi, une interprétation du libéralisme sous ses formes classique, néo- et post- comme un mode de vie complet, une formation discursive, ou encore un dispositif. Peu importe l’étiquette, nous prétendons que le libéralisme revêt à la fois un régime de vérité, une forme de subjectivité et un mode de gouvernement. Ceux-ci comprennent en quelque sorte les germes de leur propre destruction.
Genèse du postlibéralisme
Alors que Foucault a développé son analyse de « l’art libéral de gouverner » à travers la gestion « biopolitique » des populations à la fin des années 1970, sa réflexion sur le lien entre le libéralisme, la vérité (scientifique) et la subjectivité remonte au moins jusqu’à son ouvrage programmatique de 1966 : Les mots et les choses. Il débute son livre sur les ruptures épistémiques de la pensée occidentale depuis la Renaissance avec l’analyse du tableau Las meninas de Velazquez (1656), un « portrait » du roi et de la reine d’Espagne dans lequel le couple souverain occupe l’espace hors tableau où se trouve le spectateur. Foucault illustre ainsi comment l’épistémè de la représentation de l’âge classique, en rupture avec l’épistémè précédente de la ressemblance, établit l’autorité politique, absolutiste en l’occurrence, sur la raison pure du sujet pensant, capable de déduire à la Hobbes la nécessité de céder ses droits naturels au souverain. À la fin du XVIIIe siècle, la révolution épistémique (entre autres kantienne, avec sa Critique de la raison pure) amena le relativisme, le probabilisme et l’empirisme comme fondements de la « véridiction » (ou la possibilité de « dire-vrai » à propos d’une partie de la réalité empirique à partir d’un cadre particulier de connaissance) de ce que Foucault appelle l’épistémè des sciences de l’homme. La vérité se retrouvait désormais en dehors du sujet pensant dans des lois naturelles, y compris celle de la linguistique, de la biologie et de l’économie politique. Ainsi, la critique libérale du pouvoir absolutiste invoquait les limites externes au pouvoir gouvernemental, dont notamment celle du marché comme lieu de véridiction des prix et donc de l’allocation efficace des ressources indépendant de la volonté des agents, y compris le souverain. À la place de l’ambition absolutiste de contrôler tout un chacun par la juridiction sans limites du souverain, le libéralisme proposait un gouvernement limité et indirect par des incitations susceptibles, avec une probabilité plus ou moins prévisible, de pousser des sujets intéressés et calculateurs à agir de telle ou telle manière de leur propre gré.
On comprendra vite que l’université de recherche moderne a été à la fois le fruit de la nouvelle épistémè des sciences de l’homme et un instrument important de la « gouvernementalité » libérale. Si l’université prémoderne avait la mission de conserver, développer et transmettre des sciences dogmatiques comme la théologie, le droit et la philosophie et des arts pratiques comme la médecine et le caméralisme, l’université de recherche moderne a connu le foisonnement de disciplines empiriques ayant chacune ses objets et ses méthodes particuliers. Le découpage à l’infini de la réalité observable de différentes manières se justifiait par le relativisme et le pragmatisme épistémologiques. L’incertitude du probabilisme empirique prêtait à l’université de recherche un dynamisme sans pareil déjà au XIXe siècle. Avec le passage au XXe siècle du capitalisme de laissez-faire à un capitalisme de haute valeur ajoutée scientifique et technologique, la recherche universitaire a évidemment connu une explosion d’investissement public et privé. De plus, l’éducation supérieure est devenue un instrument incontournable de la gouvernementalité libérale pour forger des sujets librement performants, normalisés et disciplin(aris)és (et même prêts à s’endetter à vie pour ce faire.). L’université de recherche, et de masse, a sans doute atteint son apogée en termes de légitimité institutionnelle, sinon en rendement et investissement, dans les années 1970.
Avec l’État-providence dont elle faisait partie, l’université de recherche – qu’elle soit publique ou privée ne changeait rien au fait qu’elle dépendait massivement des dépenses de l’État – s’est retrouvée dès les années 1980 dans la mire des coupures néolibérales. Souvent mal compris comme prônant le tout- marché et le retrait de l’État, le néolibéralisme remonte bien avant l’avènement de l’État-providence, et son assaut sur la mission universitaire va bien au-delà des coupures budgétaires et des réaménagements autoritaires de l’institution des quarante dernières années. À sa naissance, dans les années 1930, le néolibéralisme, avant d’être une doctrine économique et une idéologie politique, était une position épistémologique défendue par des scientifiques et philosophes qui se méfiaient du naturalisme empirique. Contrairement au libéralisme classique qui considérait le marché avec sa « main invisible » comme une force de la nature, le néolibéralisme reconnaissait son caractère socialement construit : le marché ne distribuerait les biens de façon objectivement efficace que si les acteurs économiques se comportaient comme si le marché existait. Ainsi, alors que l’homo œconomicus libéral agissait spontanément comme agent d’échange sur le marché toujours déjà existant, l’homo œconomicus néolibéral devait se façonner comme agent de compétition afin de mettre en branle le marché. Dans la formulation de Foucault, le sujet libéral s’est transformé en « entrepreneur de soi », et pour l’aider dans son entrepreneuriat l’État devait intervenir activement – évidemment pas sur le marché, mais sur les individus, les collectivités ou la société tout entière pour les rendre toujours plus compétitifs. L’ironie de l’histoire veut que ce socio-constructivisme néolibéral originel ait subi un renversement de sens aux mains des idéologues conservateurs qui se sont ralliés aux politiques économiques néolibérales, mais en faisant de leurs fondements épistémologiques un apanage dangereux de la gauche (identitaire). On ne doit donc pas s’étonner que l’université néolibérale puisse à la fois favoriser par sa sur-administration autoritaire la marchandisation du savoir et redéfinir sa mission comme celle de l’épanouissement identitaire et de l’affranchissement de « diversités » différemment et abondamment construites, d’autant plus que les deux tendances attirent de nouvelles clientèles !
La marchandisation et la politisation de l’université par le néolibéralisme n’ont rien de nouveau et ne menacent pas forcément sa mission scientifique, nous l’avons vu plus haut. Son épistémologie constructiviste et son activisme pour transformer le sujet libéral en entrepreneur de soi ne constituent pas non plus nécessairement un danger en soi. Après tout, le constructivisme, le relativisme et le perspectivisme ont enrichi les sciences humaines et sociales depuis plusieurs siècles et les sciences naturelles depuis au moins Einstein et Heisenberg. Quant à l’entrepreneuriat, il va souvent de pair avec la créativité. Cependant, en exposant la fiction du marché comme lieu de véridiction, en semant le doute permanent quant à l’adéquation du sujet libéral comme agent économique et en mobilisant la privation et la précarisation comme techniques de gouvernement, le néolibéralisme a dévoilé les défauts intrinsèques de la véridiction, de la subjectivité et de la gouvernementalité libérales. Celles-ci traversaient évidemment les institutions du libéralisme, y compris l’université de recherche. Afin de comprendre comment le néolibéralisme est en train d’aboutir à la négation de notre modernité libérale et, avec elle, l’université, il va falloir prendre un bref détour par mes recherches sur le néolibéralisme et le postlibéralisme émergeant et passer par des considérations littéralement d’ordre général.
Ma critique du (néo)libéralisme est issue de recherches empiriques que je mène en collaboration depuis une vingtaine d’années avec l’anthropologue Mariella Pandolfi avec qui je partageais un intérêt pour les transitions postcommunistes en Europe centrale et du sud-est durant les années 1990. Les terrains sur lesquels elle travaillait, en particulier dans les zones de crises balkaniques (Bosnie, Albanie et Kosovo), nous ont permis de nous pencher sur les opérations complexes et multiples de la « communauté internationale », souvent regroupées sous l’étiquette de l’intervention humanitaire. Alors que le visage sombre du néolibéralisme des années 1990 était celui de l’austérité et de la thérapie de choc, l’humanitarisme, quant à lui, véhiculait l’image d’un néolibéralisme à visage humain, attirant ainsi des appuis de la gauche, des marxistes reconvertis aux avocats de la « troisième voie ». Les intervenants de la communauté internationale promettaient aux sociétés dites de transition un passage rapide au paradis libéral de l’économie de marché, de la démocratie représentative, de la société civile active, de la culture ouverte et tolérante et des autres « meilleures pratiques ». Toutefois, sur le terrain nous observions plutôt la pérennisation de la transition et l’instauration des états d’urgence et d’exception permanents. En effet, nous arrivions à la conclusion que l’intervention introduisait une nouvelle forme d’ordre durable que nous avons appelée la « domination thérapeutique ».
Absente de la typologie wébérienne classique des modes de domination légitime (légale-rationnelle, charismatique ou traditionnelle), la domination thérapeutique décrit une relation de commandement et d’obéissance qui, à l’instar du rapport médecin-patient, revendique sa légitimité sur la base de l’application d’un traitement impersonnel dans des circonstances extraordinaires d’urgence (imminente). Expérimentée sur des sites d’intervention plutôt périphériques du « nouveau désordre mondial », la gestion néolibérale des crises a rapidement transposé et appliqué les techniques de la domination thérapeutique (état d’exception juridique ; standard operating procedures ; gouvernement d’experts sans-frontières ; confusion des logistiques militaires, humanitaires et développementalistes.) aux pays privilégiés du centre. C’était le cas notamment pour les pays frappés par la crise des subprimes, devenue crise financière, devenue crise de dette souveraine, devenue crise monétaire, devenue crise sociale et politique.. Aujourd’hui la domination thérapeutique s’applique à l’échelle planétaire dans le contexte de la crise sanitaire.
Le gouvernement par disruption et la nouvelle épistémè de la vérisimilitude
La généralisation des crises et de leur gestion thérapeutique révèle, de fait, le rapport particulier entre l’art libéral de gouverner et un ordre social toujours susceptible d’entrer en crise. Pour le libéralisme classique, l’ordre est le produit spontané des échanges de sujets rationnels poursuivant sans coordination leurs intérêts. Pour qu’il se maintienne, il faut trouver un équilibre entre la liberté d’action des individus et leur sécurité, c’est-à-dire une certaine prévisibilité de l’action des autres, notamment par la normalisation/disciplinarisation de leurs comportements. Un gouvernement libéral parfait trouverait donc son équilibre juste au bord de la crise. Puisque le néolibéralisme reconnaissait la fragilité construite du marché et l’inadéquation permanente des sujets libéraux, il devait pratiquer le gouvernement en crise, d’où son recours à la domination thérapeutique. De ce fait, le pas vers le gouvernement postlibéral par la crise n’est pas loin. Celui-ci abandonne l’idéal de l’ordre ainsi que l’idée que la politique vise de façon cohérente et stratégique un projet de société (Justement : qui de nos jours parle encore d’un projet de société ?). Le postlibéralisme met en vigueur non seulement un gouvernement tactique et fragmentaire, mais aussi carrément et volontairement un gouvernement de « disruption ».
Vantée par des gourous du management comme tactique salutaire de la « destruction créatrice » du capitalisme, la disruption jouit désormais d’une connotation positive. Le terme fait partie de l’incursion massive dans la pensée sociale du discours néo-darwinien qui aide à réduire la domination thérapeutique néolibérale à sa plus simple expression, soit une politique brutale de survie. Que ce soit à gauche sous la forme de l’argument inclusif que la protection de la (bio)diversité nous sauvera tous, ou à droite selon l’argument exclusif que le bateau soit déjà plein, la survie est l’enjeu qui définit et structure le champ discursif politique actuel – ou ce que la novlangue darwinienne nomme : « l’écosystème » politique. Ainsi les dominés d’antan deviennent-ils les « vulnérables » de nos jours qui peuvent renverser la situation en faisant preuve de leur « résilience » et surtout en la cultivant, si nécessaire par l’automutilation. L’abus du terme « résilience » témoigne subtilement de la perte du lien social, culturel et historique comme fondement du politique. À l’origine, la résilience désignait une capacité de l’individu à rebondir d’un trauma grâce à des liens affectifs signifiants. Aujourd’hui, son usage signifie plutôt une capacité innée (novlangue : « dans notre ADN ») que l’individu doit stimuler en surmontant toujours plus d’obstacles.
Cette politique postlibérale de la survie du plus fort, où le gouvernement de soi et des autres passe par la peur et l’incertitude, va évidemment de pair avec une subjectivité propre au moment postlibéral et, ce qui nous intéresse particulièrement ici, avec une nouvelle épistémè. Alors que le sujet néolibéral est entrepreneur de soi, le sujet postlibéral pousse le projet d’auto-perfection à son paroxysme pour devenir à la fois ennemi et étranger de soi. D’une part, il faut qu’il combatte son insuffisance jusqu’à la mort. D’autre part, il faut qu’il masque son insuffisance à lui-même et aux autres. Il virtualise et déshumanise son existence, ce qui de nos jours devient objectivement, technologiquement possible et subjectivement souhaitable face à la perte de toute vérité. En effet, sous le postlibéralisme, le relativisme épistémologique du libéralisme s’est dissocié de la « réalité », qu’elle soit naturelle ou construite. On irait vite en besogne et leur accorderait bien trop d’importance si on blâmait des philosophes postmodernes ou déconstructivistes pour avoir dissous la véridiction. Leur visée était d’en critiquer les effets de pouvoir et non d’instaurer un régime où la vraisemblance, plutôt l’expression pure du pouvoir arbitraire, remplace la véridiction.
De fait, dans un revirement matérialiste, voire néo-marxiste, on pourrait dire que l’avènement de l’épistémè de la vérisimilitude (ou un régime de vérité où les simulacres, fantasmes, vraisemblances et apparences font plus appel aux émotions qu’à la raison) résulte à la fois des techniques et des crises du capitalisme (néo)libéral mondialisé. D’une part, la financiarisation de l’économie avec son invention de produits dérivés de plus en plus spéculatifs (p.ex. les subprimes) ainsi que des mécanismes désincarnés d’échange assujettis à des algorithmes et, d’autre part, la multiplication de crises sécuritaire, environnementale, migratoire, sanitaire, etc. ont haussé l’imprévisibilité des risques. Par conséquent, le principe de précaution, la planification par scénario, la prévision par marchés de paris, l’intelligence artificielle et la pêche post hoc des corrélations dans la poubelle des données (aussi appelée big data) ont remplacé les techniques pronostiques des sciences actuarielles et d’autres démarches empiriques. En d’autres mots, la plausibilité fantastique est en train de tasser la probabilité statistique! Certes, les illusions du monde des apparences menacent la recherche raisonnée de la vérité depuis au moins la caverne de Platon. Or, de nos jours, elles constituent les fondements non seulement de notre économie largement virtualisée, mais aussi d’une science de plus en plus factice.
On devrait pouvoir encore objecter que l’université de recherche est un rempart contre la vérisimilitude. Après tout, c’est l’institutionnalisation même de la véridiction empirique, où la division hyperspécialisée du travail érige autant de forteresses de méthodes et de connaissances durement acquises et jalousement gardées. Cependant, la tendance lourde de l’université contemporaine – nous l’avons déjà vu avec la course aux rankings, la promotion de la qualité et la bonification de l’expérience étudiante – est d’abandonner le productivisme acharné (certes, problématique) du néolibéralisme en faveur des apparences du marketing postlibéral.
Bien que le savoir ait souvent dû se satisfaire de la vraisemblance, celle-ci semble maintenant s’infiltrer sournoisement à travers toute l’entreprise universitaire. Quelques exemples tirés seulement de la période de rédaction de cet essai en témoignent :
- le CHUM implante un système d’intelligence artificielle afin de faire le tri dans la surproduction des articles scientifiques (soit : on fait confiance à un algorithme extérieur à la démarche expérimentale elle-même pour en déterminer la validité)
- le comité d’éthique de la recherche de l’Université de Montréal introduit une plateforme numérique pour gérer la certification en éthique des projets (soit : une démarche qui soulève des critiques, à cause de l’intervention normative des commissaires, et cherche à se cacher derrière des mécanismes supposément objectifs et donc au-dessus des critiques potentiellement correctives)
- je participe aux délibérations d’un comité d’octroi de subventions lors desquelles plusieurs membres signalent le caractère potentiellement arbitraire de différentes étapes de la procédure, mais la majorité écrasante accepte le résultat de l’évaluation parce que la procédure a été intégralement suivie (soit : l’apparence déontologique de rectitude annule les erreurs arbitraires manifestes d’une procédure respectée).
Prises individuellement, ces aberrations ne minent pas forcément l’intégrité globale de la mission universitaire de véridiction, mais quel observateur sur le terrain n’a pas vu ou vécu des phénomènes semblables ? Qui ne craindrait pas que, ensemble, ils soient annonciateurs de l’institutionnalisation universitaire de la vérisimilitude ?
1 Traduit en français sous le titre « Le métier et la vocation de savant » (et moins complètement « Science as a Vocation » en anglais) l’intitulé en allemand renvoie de fait à l’analyse que Weber, dans L’éthique protestante et l’« esprit » du capitalisme, fait du concept de Beruf attribué à Martin Luther et de son rôle dans la généalogie de l’ascèse intramondaine puisque « Beruf » veut dire à la fois vocation et métier, ou encore « profession », qui a aussi une connotation religieuse ou de croyance.
Biographie
Diplômé d’UCLA et de Harvard, Laurence McFalls est professeur titulaire de science politique à l’Université de Montréal. Outre les sujets de recherche et les implications universitaires mentionnés dans l’article, il est co-créateur de « l’anti-archive » www.open-memory-box.de et directeur de l’école doctorale transatlantique « IRTG Diversity ». En 2016, il a été nommé Chevalier de l’ordre de mérite de la République fédérale d’Allemagne pour ses recherches sur ce pays et ses contributions à la collaboration scientifique germano-canadienne.
Références
Abélès, Marc. 2006. Politique de la survie. Paris : Flammarion.
Beddeleem, Martin. 2016. Le projet scientifique d’un renouvellement du libéralisme : le néolibéralisme de 1933 à 1973, thèse de doctorat en science politique, Université de Montréal.
Duflïeld, Mark. 2019. Post-Humanitarianism: Governing Precarity in the Digital World. Cambridge: Polity.
Fassin, Didier et Mariella Pandolfi (Dir.) 2010. Contemporary States of Emergency: The Politics of Military and Humanitarian Interventions. New York: Zone Books.
Foucault, Michel. 1966. Les mots et les choses. Paris : Seuil/Gallimard. Foucault, Michel. 1997. Il faut défendre la société. Paris : Seuil/Gallimard. Foucault, Michel. 2004a. Sécurité, territoire, population. Paris : Seuil/Gallimard Foucault, Michel. 2004b. Naissance de la biopolitique. Paris : Seuil/Gallimard.
McFalls, Laurence. 2008. « Les fondements rationnels et sociaux des passions politiques : vers une sociologie de la violence contemporaine avec Weber et Foucault », Anthropologie et Sociétés 32 (3): 155-172.
McFalls, Laurence. 2010. B« enevolent Dictatorship: The Formal Logic of Humanitarian Government », dans : D.Fassin et M. Pandolfi (Dir.), Contemporary States of Emergency: The Politics of Military and Humanitarian Interventions, pp. 317-334. New York: Zone Books.
McFalls, Laurence. 2020. « Postliberalism in International Affairs », dans : K. Giesen (Dir.), Ideologies in World Politics. Heidelberg: Springer Verlag.
McFalls, Laurence et Mariella Pandolfi. 2014. « Therapeusis and Parrhesia », dans : J. Faubion (Dir.), Foucault Now. Cambridge: Polity Press.
McFalls, Laurence et Mariella Pandolfi. 2017. « Too-late liberalism: from promised prosperity to permanent austerity », dans : P. Bonditti, D. Bigo and F. Gros (Dir.), Foucault and the Modern International: Silences and Legacies for the Study of World Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Pandolfi, Mariella. 2008. « Laboratory of Intervention. The Humanitarian Governance of the Postcommunist Balkan Territories », dans : M-J. Del Vecchio-Good, S. T. Hyde, B. Good, and S. Pinto (Dir.), Postcolonial Disorders, 157-186. Berkeley: University of California Press.
Pandolfi, Mariella. 2010. « From Paradox to Paradigm the Permanent State of Emergency in the Balkans » dans : D. Fassin et Pandolfi (Dir.), Contemporary States of Emergency: The Politics of Military and Humanitarian Interventions, pp. 104-117. New York: Zone Books.
Pandolfi, Mariella et Laurence McFalls. 2009. « Intervention as Therapeutic Order », AM. Rivista della Società italiana di antropologia medica 27-28: 91-111.
Pandolfi, Mariella et Laurence McFalls. 2014. « L’intervento come ordine terapeutico », dans : G. Pizza and H. Johannessen (Dir.), Il corpo e lo stato. Perugia: Morlacchi editore. Weber, Max. 1921-22. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: Mohr. Weber, Max. 1959. Le savant et le politique (trad. J. Freund). Paris : Plon.